
12 Jan 24 Will Butler + Sister Squares attisent le feu
Échappé d’Arcade Fire après dix-sept ans de bons et loyaux services, Will Butler passe le cap de la majorité artistique en ouvrant un nouveau chapitre en compagnie de Sister Squares, groupe formé avec sa femme Jenny, sa belle-sœur Julia Shore, la chanteuse Sara Dobbs et le multi-instrumentiste Miles Francis. Après deux albums en solo, c’est donc un disque signé à cinq paires de mains qui se dévoilait sur la scène du Café de la Danse, à Paris, le 15 novembre dernier. L’occasion de discuter art, musique et littérature avec celui qui se joue des influences, des catégories et des étiquettes pour écrire désormais sa propre histoire, entre pop music et expérimentations esthétiques. Un échange érudit et généreux qui en dit long sur la profondeur de l’artiste, loin du personnage de trublion qu’il a souvent joué au sein du groupe montréalais mais qui rend aujourd’hui ses performances toujours aussi cathartiques et exaltantes.
Pour sortir ce disque, tu t’es associé pour la première fois à ton groupe de scène, Sister Squares. Pourquoi ?
Will Butler : J’ai très vite réalisé, en commençant à travailler sur ce disque, que je ne voulais pas le faire seul. J’ai donc demandé à Miles s’il était d’accord de le produire avec moi, ce qu’il a immédiatement accepté. En l’écrivant ensemble et en jouant ces nouveaux morceaux sur scène à l’occasion de petits concerts, tout est soudain devenu très concret. Nous aurions pu changer de nom, mais cela s’inscrivait en même temps dans la continuité de ce que j’avais fait jusqu’ici en solo. Nous avons donc choisi d’ajouter simplement le nom de ce nouveau groupe au mien ; ça a provoqué un déclic qui nous a aidé à finir l’album.
Comment ça s’est passé justement pour écrire, produire et enregistrer ces morceaux ?
J’ai d’abord commencé par bricoler des choses de mon côté, des sortes de démos. J’avais notamment ce petit morceau pour orgue et clarinette que j’avais joué avec Stuart Bogie, qui me plaisait bien. Je l’ai emmené avec moi dans le studio de Miles, le premier jour où nous nous sommes lancés dans la conception du disque. Nous avons travaillé dessus en y ajoutant de la basse et de la batterie, et nous nous sommes retrouvés face à cette introduction… sans avoir le morceau qui allait derrière (rires). C’est devenu ensuite Open, qui ouvre l’album et sert d’introduction, justement, au morceau Stop Talking que nous avons écrit ce jour-là.
C’est d’ailleurs une suite d’accords extraite du Prélude no. 4 en mi mineur de Chostakovitch non ?
Exactement ! Nous l’avons ralenti pour voir ce que cela donnait… et ça a super bien fonctionné. Nous nous sommes éloignés pendant un temps de cette démo, puis nous y sommes revenus. C’était en fait notre base, même si nous y avons ajouté certains éléments au fur et à mesure. Cela a donc commencé il y a un an et demi, au printemps 2022. Nous avons ensuite travaillé sur l’album pendant six mois, si l’on excepte des éléments plus anciens que nous y avons incorporés.
Cet album a une dimension très onirique, impressionniste et profondément romantique. Était-ce une intention dès le départ ? Il tranche assez avec le côté très direct et politique de Policy ou Generations, tes précédents albums…
J’ai toujours en moi cette dimension très politique, mais j’ai voulu me concentrer ici sur les émotions, la nature, notre façon de réagir face à celle-ci. C’est très romantique, dans le sens classique du terme, celui des poètes britanniques du XIXème siècle comme William Wordsworth ou Samuel Taylor Coleridge. Errer à travers les collines en pensant au monde ou en se perdant dans ses propres pensées, ce genre de choses. Je suis quelqu’un de très marqué par les idéologies, mais je voulais faire ici quelque chose qui se situe avant celles-ci, voir ce qu’il pouvait se passer.
En parlant de poésie, il me semble que tu as été très influencé par la lecture des œuvres complètes d’Emily Dickinson, ainsi que par L’Iris Sauvage, un recueil de poèmes de Louise Glück…
Oui, énormément. Emily Dickinson est une source à laquelle je reviens beaucoup, tout simplement parce qu’elle est fondamentale pour la littérature américaine et c’est avec elle que j’ai grandi. La façon dont elle communie avec le monde naturel, et quelque part le divin, me fascine, avec cette proximité, cette transcendance qui finit pourtant par échouer. Lorsque je me perds dans ses poèmes, il y a toujours cette pensée : qu’est-ce que je peux y prendre ? Après tout, son œuvre est maintenant tombée dans le domaine public, donc que pourrais-je bien donc lui voler (rires) ? Pour Louise Glück, c’est un peu différent. D’abord parce que c’est un livre, comme un témoignage, un enregistrement. Un peu comme un disque aussi, puisque c’est un recueil très structuré où chaque poème est magnifique, avec cet arc narratif absolument admirable. Comment a-t-elle fait ? Quand nous faisions le disque, nous voulions qu’il soit comme un recueil de poèmes, où chaque morceau pouvait être isolé mais aussi fonctionner dans un ensemble plus vaste, comme dans un livre.

Il y a souvent, dans tes paroles, des personnages désespérés qui semblent dans l’attente d’une forme d’interventionnisme, qu’il soit divin ou venant simplement d’une autre personne. Ce sont d’ailleurs souvent des personnages paralysés par des incertitudes ou des choix à faire. D’où ma question : dans la vie comme dans la création, es-tu quelqu’un qui doute beaucoup?
En ce moment, je n’ai pas l’impression de trop souffrir de cela puisque je fais pas mal de choses (sourire) mais, en effet, j’ai parfois la sensation d’être accablé par des choix à faire. Ceux-ci sont si subtils et pourtant ils vous apparaissent comme s’ils allaient profondément vous changer, à la manière d’une guerre ou d’une maladie. Ça semble fou, à une époque où des événements aussi monumentaux se produisent, mais c’est pourtant comme ça que je le ressens.
Il y a aussi beaucoup cette idée du cycle de la vie dans tes morceaux, marquée par une relation très forte au temps, à la mort, au sacré. Un peu comme dans les films d’Andreï Tarkovski qui, je crois, ont beaucoup compté pour toi…
Oui, surtout avec son livre au titre très parlant, Sculpting In Time [Le Temps Scellé dans sa version française, ndlr]. Je pense que la musique et le cinéma permettent de voir des choses que nous ne voyons pas autrement puisque, avec l’art, nous sommes à la fois dans le présent et le passé. Par exemple, si on regarde une peinture de Degas, on est directement plongé en 1902 même si l’on est en 2023. Quand vous regardez un film de Tarkovski, vous êtes à la fois en Union Soviétique dans les années 60, au cœur de son enfance dans les années 30 mais aussi en 2023, et tout ça en même temps. C’est une des dimensions de l’art que celle de vivre dans le présent. Comme le fait d’écouter les Beatles aujourd’hui et de se retrouver plongé en 1968 (rires), tout cela est très décousu mais en même temps très évident.
Tu sembles avoir toujours vu la scène comme un espace de performance, bien au-delà de la musique. Comment as-tu approché celle-ci avec Sister Squares pour cette tournée ?
Il y a vingt ans déjà, nous participions, ma femme et moi, à des spectacles de danse où elle était chorégraphe et où je jouais de la musique, avec d’autres amis. Et j’ai l’impression que cela n’a pas changé. Julie, Jenny et Sarah jouaient dans des comédies musicales pendant l’été lorsqu’elles étaient adolescentes. Cela pouvait être parfois ringard, incroyable ou bien horrible mais c’était un engagement, celui de toujours créer quoiqu’il arrive. Ici, il n’y a pas d’intrigues mais il y a sur la scène un espace pour bouger, pour créer des chorégraphies. Nous nous sommes donc demandés comment l’investir avec notre corps, nos mouvements. Dans notre groupe, je suis vraiment le maillon faible, puisque même Miles a pris des cours de danse lorsqu’il était enfant. Pourtant je me considère plutôt comme un bon danseur, à condition de rester dans des chorégraphies très simples. En tout cas, la danse est rapidement devenue un point d’attache pour tout le monde.

Pour revenir à la musique, au-delà de la dimension pop du disque, on y entend des influences assez pointues, souvent situées dans l’avant-garde. Je pense au travail de Meredith Monk, pour la voix, mais aussi à l’approche de György Ligeti sur des morceaux comme Me & My Friends, Good Friday, 1613 ou Hee Loop. La musique classique et contemporaine semble avoir une grande influence sur toi…
Oui, beaucoup ! C’est marrant parce que, pendant très longtemps, Good Friday, 1613 s’appelait juste ‘Ligeti’ sur nos setlist (rires). La scène New-Yorkaise minimaliste des années 70 m’a beaucoup marqué aussi, à commencer par Alvin Lucier…
À qui tu rends d’ailleurs hommage dans I’m Standing In A Room…
Exactement ! Mais je pense aussi à Steve Reich, Terry Riley, toute cette musique proche du drone. Tout cela est très présent, peut-être en partie parce que le disque à été composé à New-York. Tout cet héritage avec à la fois, les Ramones, Terry Riley ou même Madonna (rires). En empilant les blocs, on se rend compte de cette histoire très dense. J’aime puiser dans tous ces courants, comme dans la musique classique ou contemporaine, avec Chostakovitch ou Ligeti, mais tout cela n’est qu’une partie des influences, au même titre que peuvent l’être Britney Spears ou NSYNC par exemple, tout cela fait partie d’un tout.
J’ai été aussi très surpris et touché d’entendre ton hommage à Chopin sur The Window. Comment ce morceau est né ?
C’était à la fin de la pandémie, alors que je n’avais pas fait accorder mon piano depuis plus de deux ans et demi. La veille du passage de l’accordeur, j’ai appelé Julie, qui est une excellente pianiste, pour lui demander de venir jouer tout ce qu’elle connaissait de mémoire. Elle est venue et a notamment joué cette Nocturne [en mi bémol, opus 9 n°2, ndlr]. Je l’ai enregistrée sur cassette puis je l’ai passée au ralenti, sans savoir si nous allions l’utiliser. C’était comme une sorte de sample, avec Julie qui jouait quelque chose de très familier sur ce piano désaccordé. La question a été ensuite de savoir comment faire une sorte de nouveau gâteau avec cet ingrédient (rires).

Pour revenir à ton parcours, je me demandais quelles étaient tes relations avec la politique aujourd’hui. Tu as obtenu un master en politique publique à Harvard en 2017 et mené plusieurs réunions pour débattre de sujets de société aux États-Unis. Qu’est-ce que tout cela t’a apporté, d’un point de vue artistique ou personnel ?
Cela évolue toujours, mais je suis dans une phase où je prends un peu de recul vis-à-vis de tout ça. Quelque part, tout est politique, et nous devons nous battre à tous les niveaux. C’était très étrange de traverser la pandémie avec ce sujet à la fois entre les mains de la nature, dans celles des technocrates et assez peu dans celles des citoyens, avec toutes ces incertitudes. Mais quelle que soit votre position sociale ou la période que vous traversez, il y a toujours un levier sur lequel vous pouvez agir. Par exemple, au travail, il est possible d’agir sur le droit des travailleurs avec les syndicats. À la maison, ce sera plutôt sur le volet de l’éducation. Mais je pense être dans une phase où je suis un peu perdu vis-à-vis de tout ça, car les États-Unis sont vraiment un endroit étrange en ce moment (rires).
Tu as d’ailleurs déménagé récemment à Brooklyn si j’ai bien compris ? Qu’est-ce que cela change au niveau de ta musique ou de ta vie en général ?
En effet, nous sommes maintenant dans le Sud de Brooklyn et j’adore ça ! Il y a une grande forme d’humanité, nous sommes proches de tout un tas de gens différents. On est près du quartier Uzbek, des quartiers géorgiens. On entend vraiment toutes les langues ! Des vieilles dames bangladaises qui se disputent, des juifs qui vont prier, des russes qui débattent dans la rue. Et lorsque nous nous rendons dans la charcuterie polonaise, il y a vraiment tout le monde, en même temps. Tout cela est très encourageant. Ce n’est pas non plus une utopie, mais c’est très beau de voir tous ces gens différents réunis dans un seul et même grand espace. New-York est une ville loin d’être parfaite, mais il y a une grande sphère publique que tout le monde utilise, riches comme pauvres, à l’image des parcs par exemple. Et je me dis que c’est bien. Un peu comme le métro, dans lequel il règne un certain désordre, mais tout le monde est là, et je me dis que c’est une bonne chose.
Tu as récemment travaillé sur la musique d’une pièce de théâtre, Stereophonic de David Adjmi. Tu vas aussi prochainement réaliser la bande-originale du film Lips Like Sugar de Brantley Guttierez, près de dix ans après ton travail sur celle du film Her de Spike Jonze. Comment naissent ces envies et ces opportunités ?
Tout cela est arrivé très naturellement, presque de façon accidentelle. Pour Stereophonic, c’est merveilleux car cela est vraiment venu d’une rencontre fortuite, tout comme pour un autre projet pour le théâtre que je prépare, même s’il n’en est qu’à ses tout débuts. J’aime ces collaborations, ou plus simplement le fait de créer quelque chose avec d’autres personnes. Je le fais au niveau de la musique car c’est là où je suis le meilleur au fond, mais je préfère être perçu comme collaborateur qu’en tant que musicien tant il y a cet échange, cette empathie active où vous entrez dans la tête de l’autre et vice-versa, pour le meilleur, que ce soit pour un film ou pour une pièce de théâtre.
As-tu déjà pensé à passer derrière la caméra, ou du moins écrire quelque chose pour le cinéma, en dehors des collaborations pour la musique ?
J’adore le cinéma, tout comme les clips. J’aime les idées visuelles. Mais cela coûte tellement cher de faire un film… C’est pour cela que je pense que je ne le ferai jamais, parce que ça doit être un vrai cauchemar. Mais j’aime être en contact avec ce monde, j’ai d’ailleurs un ami qui est directeur de la photographie à New-York et qui me permet de comprendre à quel point tout cela est un sacré processus (rires).
Je ne peux pas te laisser sans te poser cette question : quitter Arcade Fire était-il nécessaire pour toi ? Quels souvenirs gardes-tu de toutes ces années passées au sein du groupe ?
C’était vraiment sympa. Après mon départ, je me suis senti extrêmement bien, et c’est toujours le cas, même si je ressens encore à quel point tout cela constitue une grande partie de moi. Je suis très fier du travail que nous avons fait. Je pense parfois à Paul Simonon des Clash. Je ne sais pas pourquoi il a quitté le groupe, mais pour tout le monde c’est ‘le mec des Clash’. Donc je comprends qu’en me voyant les gens disent ‘oh, c’est le mec d’Arcade Fire‘ (rires). Et je suis en paix avec ça, car c’est un héritage qui en vaut la peine. Un peu comme pour Paul Simonon finalement, où j’aime autant ce qu’il a fait en dehors des Clash qu’avec eux. Cela m’a permis de me sentir un peu plus moi-même, et cela fait du bien, parce que ça a du sens. J’ai pris cette décision sans savoir ce qui allait se passer, mais pour l’instant tout va très bien (rires).
Photos : Alexa Viscius, Will Butler
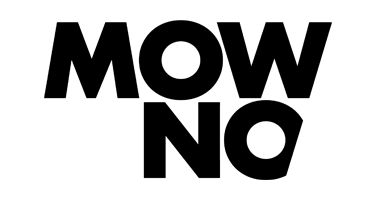







Pas de commentaire