
23 Sep 16 Interview – Electric Electric, machine sauvage
‘La digne réponse française aux Américains de Health ou Battles‘. Voilà ce qu’annonçait en 2012 une critique de ‘Discipline‘, second album d’Electric Electric. A sa relecture, on s’interroge encore sur cette obsession nationale qui consiste à comparer chaque scène, comme si l’une incarnait à jamais le bon élève dont il fallait à tout prix calquer les réussites. D’autant que, depuis près d’une décennie, la France n’a plus grand-chose à envier – que ce soit en termes de quantité ou de qualité – aux faiseurs de bruit américains. Du math-rock au garage teigneux, en passant évidemment par le noise-rock ou le post-rock, on ne compte plus les mains et les cerveaux aussi géniaux que franchement désaxés qui œuvrent dans l’ombre, de Strasbourg à Bordeaux. Et parmi eux, ceux d’Electric Electric font figure d’inclassables. Ecoutez leurs disques, allez à leurs concerts : il y a toujours un truc que vous ne pigerez pas. Et ce n’est pas grave. Sous ses airs de musique savante, la leur se prend comme une grande baffe dans la gueule avant de vous faire danser comme un névrotique. A l’occasion de ‘III‘, son troisième album, Eric Bentz – tête de proue du trio – a accepté de nous parler de ses inspirations, de sa façon de concevoir la musique, aussi bien en studio qu’à travers l’observation.
Alors, pas trop flippé par la sortie de ce nouvel album ? ‘Discipline’ avait bénéficié d’un super accueil critique…
Éric Bentz : Tu penses qu’on va se planter ? (il se marre, ndlr). Tu sais, quand est sorti ‘Discipline’ en 2012, j’étais au RSA avec un diplôme d’éducateur spécialisé. Et puis à ma grande surprise l’album a bien marché, et on a pu tourner dans le monde entier. C’est à partir de là qu’on a acquis le statut d’intermittents du spectacle. Mais on ne se met pas la pression par rapport à ça. Souvent, je me dis que la fête est bientôt finie, et qu’il va falloir passer à autre chose. De la musique, on continuera à en faire dans tous les cas.
Je trouve que ‘III’ rompt de façon assez nette avec ‘Discipline’. Il est beaucoup moins chargé en percussions, les atmosphères sont plus insidieuses…
Lorsque j’essayais de me conditionner et d’écrire des choses dans le cadre où on nous attendait, rien ne retenait mon attention. J’ai vite réalisé que j’étais sur la mauvaise voie. La première véritable impulsion vers ce disque a été une sorte de rejet de l’esthétique du groupe. C’est avec un vieux synthé analogique couplé à mes pédales d’effets que j’ai retrouvé le plaisir de faire de la musique. Je me suis mis à travailler des heures et des heures sur des textures, des choses très sommaires. De fait, je me suis vite retrouvé avec six ou sept démos d’une musique nébuleuse et étrange, sans une seule note de guitare, ni même de batterie. Je fantasmais l’idée de faire un disque très différent, plus lent, qui évoquerait un état de tension plus sourd. J’étais à la recherche d’un climat en somme.
En parallèle, le groupe avait monté deux morceaux, à partir d’idées que Vincent (Robert, Ndlr) avait amenées. Des morceaux que nous jouions en live et qui s’inscrivaient dans la continuité de ‘Discipline’. A partir de là, nous avons fait le lien entre les deux univers. C’est seulement dans les dernières sessions de travail que je me suis mis à retravailler des choses très rythmiques. Le titre ‘Pointe Noire’ en est un bon exemple.

Ce nouveau son, c’est seulement une réaction par rapport à ce qui vous caractérisait avant ou il faut le considérer dans un environnement plus large ?
Mon implication dans la musique s’est toujours articulée autour de frustrations sociales, politiques. Ce qui a aussi été le cas pour ce disque. L’état de tension dans lequel nous vivons tous, cette forme de violence avec laquelle nous devons avancer a surement été déterminant pour le son du disque. Le concept d’impuissance face à des mesures dangereuses mises en place par une oligarchie aussi. Cette expérience de l’impuissance politique mêlée au bonheur d’être un jeune père crée un drôle de sentiment.
L’hyper-connectivité est aussi une source d’angoisse permanente. Il s’agit de se protéger mais tout cela a généré une tension qui a fini par exploser et qui s’est transformée en quelque chose de positif.
Tu parles d’hyper-connectivité. Pour le coup, on ne peut pas vous reprocher de submerger les réseaux sociaux avec des publications. Vous êtes pratiquement absents contrairement à une majorité de groupes aujourd’hui.
On est mauvais pour ça. Le groupe a une page Facebook mais ce sont les labels qui la gèrent. En revanche, on n’a pas de site Internet… Enfin si ! Mais on a perdu les codes d’accès… Tu vois à quel point on est des brèles ! Disons plus sérieusement qu’on se tient volontairement à distance de tout ça. Le jeu de l’hyper présence ne m’intéresse pas. Je préférerais disparaître totalement.
Pour en revenir à l’album, il y a un morceau très surprenant qui s’appelle ‘Les Bêtes’. On y entend un chant en français très mis en avant alors que d’habitude, vous utilisez plutôt la voix comme un élément parmi d’autres. Tu peux m’en parler un peu ?
C’est le dernier morceau sur lequel on a bossé. A la base, c’était juste un bout d’instru électronique dont on ne savait pas trop quoi faire. Comme il y avait déjà de la voix sur tous les autres morceaux de l’album, je ne voulais pas que ce titre en particulier sonne comme ‘la plage abstraite du disque’. Du coup, je me suis dit que ce serait génial d’inviter un ami à nous – qui s’appelle Philippe Poirier et qui vit aussi à Strasbourg – pour chanter dessus. C’est l’ancien musicien d’un groupe assez mythique du coin qui s’appelle Kat Onoma. Il évolue dans la chanson française expérimentale avec un vrai rapport à la poésie. Quand je lui ai proposé, il a été surpris mais emballé. Dans un premier temps, il est arrivé avec un texte court qu’il répétait. Mais c’était trop proche de ce que je pouvais faire avec le groupe. Il parlait de Kaspar Hauser [un adolescent sauvage qui est apparu sur une place à Nuremberg en 1826 et dont personne ne connait les origines, ndlr]. C’était vraiment bien, mais je trouvais qu’il recréait trop le cadre de fond d’Electric Electric. Je cherchais un truc plus singulier. Il avait aussi un second texte, plus long. Il me l’a lu, je l’ai trouvé très beau et nous avons affiné sa structure ensemble. Cela a abouti à ‘Les Bêtes’. Je suis très heureux de cette collaboration. Je trouve que le résultat est un peu différent de ce qu’on avait fait jusque-là.

C’est vrai que ce morceau sonne différent. Mais sur le fond, il porte vraiment l’ADN Electric Electric. On y retrouve cette écriture un peu froide et cérébrale, et en même temps primaire et insaisissable. Tout ça pour te dire que j’aimerais connaître ton parcours musical, histoire de savoir comment on aboutit à Electric Electric.
Je suis autodidacte. Il y a toujours eu des instruments chez moi. Mes parents avaient récupéré une batterie lorsque j’étais enfant. J’ai commencé à en jouer très petit, dès quatre ans. Et puis à l’adolescence, j’ai pris part à des groupes assez rapidement. Différentes formations plutôt rock. Puis j’ai découvert le free jazz vers 20 ans et mon jeu s’est ouvert. Ces années ont été très riches pour moi. Ensuite j’ai été attiré par la guitare que j’ai quasiment tout de suite expérimentée avec un looper. A cette période je me suis remis à écouter des groupes bruyants à guitare. Du noise rock, des musiques expérimentales… Et puis j’ai aussi découvert la musique contemporaine. Ma conception des formes s’en est trouvée bousculée. Mon fantasme aujourd’hui est de travailler à partir d’éléments sonores concrets, le monde de la prise de son naturaliste me fascine, par exemple.
On considère souvent que ce sont les trucs que vous écoutez ado qui déterminent votre rapport à la musique pour les années à venir. Comme votre musique est carrément impossible à ranger dans une catégorie, je suis curieux de connaître les différents disques qui, toi, t’ont marqué pendant cette période.
C’est toujours l’histoire du grand frère qui te fait découvrir des trucs…. Pour moi, c’est le cousin de mon meilleur pote qui nous a fait écouter un tas de groupes punks et cold-wave. Les disques de Joy Division ou de The Cure me mettaient dans un état que je ne retrouverai plus jamais. Ils me terrassaient. J’avais l’impression de mourir à chaque fois !
Tu avais quel âge à ce moment-là ?
Treize ans. Après, je te dis que ces groupes me donnaient l’impression de mourir, mais pourtant ils me rendaient heureux comme rien d’autre n’y parvenait ! Par la suite, j’ai plutôt écouté les groupes de ma génération : Les Bérus, Nirvana, Sonic Youth… D’ailleurs le documentaire ‘The Year Punk Broke’ m’avait vachement marqué. Il y a aussi eu des trucs plus bourrins comme les premiers Sepultura, Brutal Truth, Fudge Tunnel, Jesus Lizard, le free-jazz avec Coltrane, l’indie-pop que je découvrais grâce à Ray Cocks et son émission 120 minutes ! Puis encore Daft Punk, les raves parties…. C’est la singularité de tous ces projets qui m’a marqué, leur absence de compromis. Ces groupes me paraissaient exprimer des doutes mais avec une assurance qu’ils te crachent à la gueule.

‘Discipline’ avait été produit par quatre structures différentes (les labels Africantape, Murailles, Kythibong et Herzfeld). Aujourd’hui il n’en reste que deux au générique. Africantape a baissé le rideau et on n’entend plus beaucoup parler d’Herzfeld.
Herzfeld est moins actif ces derniers temps. Mais un label, c’est une histoire de personnes. Et ils vivent leur histoire au jour le jour en fonction de l’investissement de chacun. Je sais néanmoins qu’un disque va sortir bientôt!
Tu n’as pas l’impression que la scène française, au niveau des labels, est aujourd’hui hyper-active mais que paradoxalement elle est aussi plus fébrile?
Je ne suis pas un spécialiste des labels français. Mais je n’ai pas l’impression qu’il y en ait de plus en plus. Au contraire, j’apprends régulièrement qu’il y en a qui lâchent l’affaire. Et si tu veux parler des micro-labels, pour moi, ils ont toujours existé. Aujourd’hui, on les retrouve plutôt sur Bandcamp. Mais si je respecte le boulot de ces labels qui sortent parfois des trucs très bons, je ferai toujours le distinguo entre un label qui s’attelle à sortir des disques en vinyle et CD et ceux qui restent uniquement sur le digital.
Tu résides toujours à Strasbourg. Tu penses que cette ville à une influence sur ta conception de la musique ?
Je ne sais pas vraiment. Ce sont les acteurs d’une ville qui lui influent une énergie propre. Et à Strasbourg, on a une scène qui sent bien la loose ! Parfois c’est chiant, mais parfois ça fait sacrément mouche. La question c’est : est-ce que je suis influencé par ce mood ? Chaque bon concert laisse des traces, et à Strasbourg j’ai plus de chances de prendre une claque sur une musique qui fait mal que sur un groupe de zouk- love… Est-ce son climat qui influence ça ? Sa proximité avec l’Allemagne ? Sa sensibilité face à une culture Européenne ? Je n’en sais rien.
C’est le critique musical et essayiste Simon Reynolds qui parle de fluidification, pour désigner le fait qu’avec Internet et les nouvelles technologies, la notion de particularité locale existe de moins en moins dans la musique. A tel point qu’un phénomène d’homogénéisation et de stagnation se produit.
Cette fluidification me fait chier. Plein de groupes aujourd’hui sonnent exactement comme plein d’autres groupes dans le monde. Et on finit par s’emmerder dans le Village Global ! Quand j’ai commencé à bosser sur le disque, je me suis tenu volontairement à distance de toutes les sorties musicales. J’avais juste récupéré tous les vinyles de musique classique du grand-père de ma copine. C’est le genre de trucs qui aujourd’hui me donne l’impression d’avoir une oreille vierge, d’être surpris, ému, parfois gêné aussi… Il faut que je sorte de l’analyse. Et pour ça, j’ai besoin de musiques que je ne maîtrise pas.
![]()
![]()
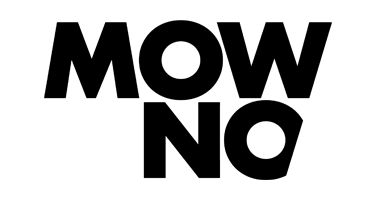



Pas de commentaire