
09 Juin 15 Interview – Marietta, bidouiller n’est pas tromper
 Guitariste et chanteur chez les excellents The Feeling of Love, Guillaume Marietta a récemment dévoilé son premier album solo ‘Basement Dreams Are The Bedroom Cream‘ à l’Hexagone ébahi. Derrière cette première escapade, dix morceaux à l’intérieur desquels mille et un bidouillages se côtoient en toute liberté. Tendrement travaillées par les effets et le quatre pistes de son géniteur, ces chansons sont marquées (entre autres) par le sceptre du lo-fi, la figure de Syd Barrett, et sont déjà promises à une vie prospère et douce sur toutes les chaînes hi-fi du pays. Pour en savoir plus sur les tenants et aboutissants de cette affaire, nous sommes allés rendre visite à Guillaume Marietta, qui nous a gentiment reçu chez lui pour nous expliquer la teneur de ce nouveau projet.
Guitariste et chanteur chez les excellents The Feeling of Love, Guillaume Marietta a récemment dévoilé son premier album solo ‘Basement Dreams Are The Bedroom Cream‘ à l’Hexagone ébahi. Derrière cette première escapade, dix morceaux à l’intérieur desquels mille et un bidouillages se côtoient en toute liberté. Tendrement travaillées par les effets et le quatre pistes de son géniteur, ces chansons sont marquées (entre autres) par le sceptre du lo-fi, la figure de Syd Barrett, et sont déjà promises à une vie prospère et douce sur toutes les chaînes hi-fi du pays. Pour en savoir plus sur les tenants et aboutissants de cette affaire, nous sommes allés rendre visite à Guillaume Marietta, qui nous a gentiment reçu chez lui pour nous expliquer la teneur de ce nouveau projet.
Comment est né ce projet?
Guillaume Marietta: Assez spontanément, pendant des moments de vide ou j’étais chez moi à Metz, dans mon petit appartement. Je n’étais pas en tournée, j’étais sans ma fille et ma copine, un peu tout seul. C’est venu du désœuvrement. J’ai toujours besoin de faire de la musique, et comme les musiciens de The Feeling Of Love n’étaient pas disponibles à ce moment-là, je me suis remis à composer tout seul et à réenregistrer sur un quatre-pistes, comme au tout début du groupe. Ça faisait quelques temps que j’avais un peu laissé tomber ça, et j’ai voulu y retourner, je sentais que j’en avais besoin.
Est-ce que le quatre-pistes était une manière intimiste et plus cohérente de faire de la musique en solo, dans ton coin, de manière un peu simple?
Ça aide beaucoup. Il y a des gens qui bossent plus sur ordinateur, mais moi ce n’est pas mon cas. J’aime bien travailler avec un quatre-pistes: c’est plus direct, il y a moins de boutons et de possibilités. Tu es obligé de faire des choix et de trancher. J’aime beaucoup les défauts du quatre-pistes, de la cassette, ce côté où tu fais ta petite cuisine dans ton coin.
Quelle forme prenait les morceaux au fur et à mesure que tu composais?
J’essayais justement de ne pas trop réfléchir à ça, et d’y aller vraiment à l’intuition, en n’essayant pas de prévoir comment ça allait sonner. Je voulais que ce soit des chansons qui tiennent la route toutes seules, avec un chant et une guitare acoustique. Une fois que la structure était assez solide à mon goût, je passais à l’enregistrement, et la pseudo-directive que je me donnais était de m’amuser et de bidouiller avec tout ce que j’avais sous la main.
Avec quoi tu bidouillais tes morceaux?
D’abord avec le quatre-pistes, parce que c’est tellement pourri que le son se parasite tout seul. J’avais aussi ma fidèle boite à rythme que j’utilise depuis des années, une imitation Farfisa, je me suis acheté une guitare folk pour la première fois de ma vie, j’avais des pédales Fender, un sampler sur lequel il y a plein d’effets tout pourris mais que j’aime bien. J’avais aussi envie de prendre le risque d’avoir pas mal de morceaux sans rythmique, de faire en sorte que la ballade folk tienne suffisamment la route pour qu’elle puisse se passer de beat. C’est pour ça qu’il y a quelques chansons sans boites à rythme, ou sans batterie sur l’album.
Du coup, la base de tes influences quand tu jouais guitare-voix, c’était le folk?
(Il réfléchit) J’ai un peu du mal avec les genres. On va dire que c’est peut-être plus un truc folk, mais je ne saurais même pas quoi te donner comme références. Ce ne sont pas vraiment des références folk. J’aime beaucoup les chansons de Syd Barrett en solo: elles tiennent très bien la route avec juste sa voix et sa guitare, mais est-ce que c’est vraiment du folk? Pas vraiment, c’est plus un truc bâtard, un mélange de toute la musique populaire jusqu’à lui. Et puis, c’est une musique qui a beaucoup évolué aussi. Ce n’est pas vraiment ça, l’idée c’était juste d’avoir des bons morceaux.

A quel moment de la composition tu t’es dit que ces chansons pourraient constituer ton album solo?
Quand je me suis retrouvé avec une dizaine de morceaux et que, tous mis bout à bout, j’ai trouvé qu’il y avait une cohérence entre eux. Au départ, c’était juste impulsif, pour me décharger de tous ces trucs que j’avais en moi. Il fallait que ça sorte.
C’est à ce moment-là que tu as fait appel à Olivier Demeaux du groupe Cheveu? Qu’est-ce que tu voulais qu’il apporte à l’enregistrement?
 Me dire dès le départ que ça restait des démos m’a permis de me libérer aussi. J’avais pas du tout dans l’idée que ça sorte tel quel. Du coup, ça m’a enlevé de la pression. J’en avais rien à foutre que ça sonne crado, ou de tester des conneries. Et puis après, quand j’ai vu que toutes ces bêtises et toutes ces bidouilles marrantes donnaient beaucoup de charme et de personnalité aux morceaux, je me suis dit que c’était dommage de ne pas s’en servir. En studio, je n’aurais pas eu cette marge de manœuvre pour m’amuser. J’ai donc décidé de garder toutes les prises. Mais pour les mixes que j’ai fait chez moi, je n’avais pas de carte son et pas de logiciel de montage, il y avait donc une limite technique. Du coup, à un concert de The Feeling Of Love et de Cheveu, j’ai discuté avec Olivier en fin de soirée de ce que j’étais en train de foutre. Je lui ai demandé si ça l’intéressait de reprendre les enregistrements avec moi, et qu’on bosse ensemble parce que c’est quelqu’un que je connais depuis longtemps. On vient un peu du même milieu DIY, et je sais qu’il arrive à bien faire sonner des trucs qui sont crades à la base. Je sentais qu’on se comprendrait et que ça marcherait. Effectivement, ça s’est super bien passé avec lui.
Me dire dès le départ que ça restait des démos m’a permis de me libérer aussi. J’avais pas du tout dans l’idée que ça sorte tel quel. Du coup, ça m’a enlevé de la pression. J’en avais rien à foutre que ça sonne crado, ou de tester des conneries. Et puis après, quand j’ai vu que toutes ces bêtises et toutes ces bidouilles marrantes donnaient beaucoup de charme et de personnalité aux morceaux, je me suis dit que c’était dommage de ne pas s’en servir. En studio, je n’aurais pas eu cette marge de manœuvre pour m’amuser. J’ai donc décidé de garder toutes les prises. Mais pour les mixes que j’ai fait chez moi, je n’avais pas de carte son et pas de logiciel de montage, il y avait donc une limite technique. Du coup, à un concert de The Feeling Of Love et de Cheveu, j’ai discuté avec Olivier en fin de soirée de ce que j’étais en train de foutre. Je lui ai demandé si ça l’intéressait de reprendre les enregistrements avec moi, et qu’on bosse ensemble parce que c’est quelqu’un que je connais depuis longtemps. On vient un peu du même milieu DIY, et je sais qu’il arrive à bien faire sonner des trucs qui sont crades à la base. Je sentais qu’on se comprendrait et que ça marcherait. Effectivement, ça s’est super bien passé avec lui.
 Mais il a apporté quoi précisément?
Mais il a apporté quoi précisément?
Plein de choses. Il a réussi à faire en sorte de garder l’âme de l’enregistrement tout en lui donnant plus de lisibilité dans l’écoute. Quand tu mixes directement depuis un quatre-pistes, les pistes ont tendance à s’entasser entre elles et, à la fin, ça donne ce côté très cool aussi, ou les choses se mélangent et donnent une certaine tenue à l’ensemble du morceau. Mais au bout d’un moment, tu as du mal à faire ressortir certains instruments. Ça a pris du temps avant de trouver vraiment cet équilibre là. On a un peu tâtonné parce que, quand tu numérises des pistes, il y a un côté un peu plus dur, un peu plus froid, ou justement les choses ne se mélangent plus mais se séparent. Là, il fallait les remettre ensemble.
Parmi les influences citées dans la bio de l’album, pas mal de songwriters sont listés: Bill Callahan, Bob Dylan… Est-ce que cet album a été l’occasion de te replonger dans des albums que tu n’avais pas écouté depuis longtemps et qui, du coup, retrouvaient alors une pertinence parce qu’ils s’inscrivaient dans ta démarche solo?
Non, ça, ce sont des gens que j’écoute tout le temps, depuis des années. Et ça faisait longtemps que ça me travaillait de pouvoir faire ça. Ça vient d’un concert, il y a très longtemps: j’étais parti jouer à Lille avec The Feeling Of Love mais, quand j’étais tout seul, je jouais dans The Anals, le groupe de mon frère et de Nafi de Scorpion Violente. On avait cette date dans un bar: on s’est pointé, et ils avaient fait zéro promo. On s’est donc retrouvé à faire la balance, et à attendre le public qui n’est jamais venu. C’était horrible, on était vraiment hyper dégoûté. On est donc parti à l’hôtel, on s’est pris une chambre dans un Formule 1 avec des bières, et on a allumé la télé. Il y avait un docu sur Bob Dylan sur Arte. Et je l’ai vu là, à jouer en noir et blanc, tout seul avec sa guitare et son harmonica. Il avait l’air tellement vener’ sur son jeu de guitare. Je le voyais faire ses trois mêmes accords qui tournent en boucle pendant sept minutes, en soufflant des notes stridentes dans son harmonica. Et je me suis dit que, en fait, ce n’était pas loin de ce que je faisais: ce côté répétitif, tendu, énervé, et assez agressif dans le timbre de la voix. Il y a un truc qui s’est passé à ce moment-là, qui n’a pas arrêté de me poursuivre toutes les années après, et qui est encore là. C’est un cheminement.
Avant, tu voyais sa musique comme du ‘rock à papa’?
 Oui voilà, ce truc de vieux con, un truc chiant de folkeux casse-couilles qui chantent la paix sur Terre. Mais j’ai senti qu’il y avait beaucoup plus de singularité et de subtilité chez lui, et ça m’a vraiment sauté aux yeux ce soir-là. Précisément, quand je suis un peu désemparé, ou quand j’ai des moments de doutes, je sais que je peux retourner chez lui et que ça va toujours me sauver.
Oui voilà, ce truc de vieux con, un truc chiant de folkeux casse-couilles qui chantent la paix sur Terre. Mais j’ai senti qu’il y avait beaucoup plus de singularité et de subtilité chez lui, et ça m’a vraiment sauté aux yeux ce soir-là. Précisément, quand je suis un peu désemparé, ou quand j’ai des moments de doutes, je sais que je peux retourner chez lui et que ça va toujours me sauver.
Il y a d’autres figures chez qui tu peux retourner comme ça, à part Dylan?
Je crois que c’est surtout chez lui. Avec Lou Reed et Syd Barrett, ce sont les trois plus importants pour moi.
Est ce qu’il y a des figures littéraires qui t’ont marqué aussi?
Je pense à Williams Burrough chez qui, en une page ou deux, tu vas avoir plein de strates comme ça, qui se mélangent. Tu rentres dans une pièce, tu ouvres la porte de derrière, et tu vas passer dans un autre pays, à une autre époque, et tu deviens une autre personne, à une époque antérieure ou futuriste. Tu peux basculer dans la science-fiction ou le polar avec une atmosphère de conspiration ambiance guerre-froide, et après tu vas aller dans un endroit où il n’y a que des junkies qui se shootent. Tu es balancé comme ça d’un univers à un autre. Il y a beaucoup d’humour chez lui aussi. J’essaye d’en avoir un peu dans le mien. Ce ne sont pas des blagues, mais je pense qu’il y a un peu d’autodérision.
 De Plastobéton à The Feeling of Love, tu joues toujours dans des groupes très différents. Maintenant, tu as cet album solo. A chaque fois, tu développes des nouvelles nuances…
De Plastobéton à The Feeling of Love, tu joues toujours dans des groupes très différents. Maintenant, tu as cet album solo. A chaque fois, tu développes des nouvelles nuances…
Personnellement, de ‘Dissolve Me’ jusqu’à cet album solo, j’ai l’impression d’être dans une continuité, de commencer à travailler sur un format qui est plus celui de la chanson. Je travaille un petit peu plus les mélodies, d’un point de vue vocal également. Je ne cherche pas seulement à me brancher et à gueuler dans un micro. Depuis cet album-là, je suis plus ou moins parti dans une direction à laquelle je me tiens à peu près. Pour ce qui est de Plastobéton, c’est un groupe que j’ai commencé il y a longtemps maintenant, qui est parti sur des bases qui sont toutes autres. C’est un groupe dans lequel je n’écris pas les textes, dans lequel je ne chante pas. Là, pour le coup, je travaille plus la guitare que la composition, je cherche des sons, des dynamiques, ce n’est pas la même chose. Mais ça vient aussi de ce qu’on a fait quand on a commencé la musique à Metz avec mon frère, Sébastien Joly et Nafi: faire plein de groupes à chaque fois différents. A l’époque, on en avait tous au moins dix. Un groupe plutôt rock, plutôt noise, plutôt punk, plutôt musique expérimentale improvisée. On a même essayé de faire un groupe de funk avec Nafi. Ca s’appelait Funk Police, on a juste fait un album qui est sorti chez AVANT! , un label italien.
Quels sont tes projets à venir?
Il y a toujours des dates avec The Feeling of Love: le Psych Fest le 2 juillet, un Psych Fest à Liverpool le 26 septembre. Et puis, à côté de ça, je travaille avec une danseuse et une chorégraphe qui s’appelle Aurélie Gandit, et qui a une compagnie appelé La Brèche. On a monté un spectacle il y a un an qui s’appelle ‘Cease To Know’. On le joue en octobre à l’Arsenal à Metz. Il y aura peut-être un concert de Marietta dans la foulée.
Dans le descriptif de ce collectif, il y a deux éléments qui te présentent: la fondation du fan club français des Bulls en 93, et assister au dernier concert français de Nirvana un an plus tard. Que représentent ces deux événements pour toi? Un condensé de tes années 90?
Pour moi, et c’est ce qui est bien avec les icônes, c’est une manière très simple de voir et de lire une époque. Quand tu vois une photo de Bob Dylan, tu as les années 60 qui t’arrivent en pleine gueule. Et quand tu vois une photo de Michael Jordan ou de Kurt Cobain, tu as les années 90. A partir du moment où j’ai commencé à faire des études d’arts plastiques, j’ai fait pas mal de fanzines aussi. Très vite, quand il a été question de s’amuser à partir de détournements d’images ou de choses comme ça, d’aller chercher dans les poubelles ou dans les trucs qui traînent chez toi ou chez tes parents, ces deux personnages-là sont apparus. Quand tu fais un travail un peu introspectif ou autobiographique, et que tu veux le rattacher à quelque chose de plus large, ça marche bien avec ces deux-là.
C’est la décennie qui t’as le plus marqué en termes d’influences?
Non, ça m’a marqué psychologiquement en tant qu’individu, mais ce n’est pas forcément là où je retrouve mes influences. En général, je vais toujours puiser dans le vivier artistique anglo-saxon de la fin des années 60, mais avec ma propre expérience de mec qui a grandi en France dans les années 90 et 2000. J’aime le bouillonnement qu’il y avait à la fin des années 60, ou tout le monde se mettait à bosser ensemble. Les musiciens pop, les poètes, les plasticiens, les junkies, les travelots… Tout le monde commençait à se mettre ensemble et à se mélanger. C’est pour ça que je trouve que la Factory est un modèle, une œuvre d’art en soi. Et puis il y avait un côté un peu indé puritain dans les années 90.
 Puritain?
Puritain?
Ouais, tout ce qui faisait ce cirque rock’n’roll avant – les drogues, les groupies, etc… – a été vachement mis de côté dans les années 90. C’est le moment où il y a eu le début des Riot grrrl, c’était plus cadré, plus politiquement correct. Le fait que Kurt Cobain soit héroïnomane n’en a pas fait un héros mais une victime. J’ai grandi là-dedans, avec ce truc du genre: ‘faut pas se vendre au patron, faut pas se droguer, faut pas traiter les filles comme de la merde’. J’ai grandi avec cette ligne de conduite, donc c’est un peu un mélange des deux.
Dans une interview pour Noisey, tu disais que tu voulais trouver ton propre langage musical. Je me demandais si c’était quelque chose de plus facile à trouver en solo, quand tu es débarrassé de la notion de groupe…
Je pense que oui, mais ta manière de trouver ton propre langage se nourrit aussi des autres. Donc, l’autarcie, ça ne marche pas, enfin pas chez moi ni chez la majorité des gens, je pense. Mais effectivement, il y a un moment où il faut se retrouver seul, travailler tout seul pour vraiment savoir où tu veux aller et comment tu vas t’y prendre. C’est un moment particulier qui est difficile à partager avec les autres alors, ensuite, il faut savoir en sortir pour voir si ce que tu commences à faire marche avec autrui. Je sais que, quand j’enregistrais ces chansons, il m’est arrivé quelques fois de prendre ma guitare folk et d’aller jouer chez Henri (le bassiste de The Feeling Of Love) les quelques riffs que j’avais trouvé. C’était juste pour les jouer avec lui, pour voir comment il jouait dessus afin de me rendre compte si j’étais dans une bonne ou dans une mauvaise direction, pour savoir ce qui marchait ou pas, même si ça ne m’empêchait pas de retourner ensuite faire ma sauce dans mon coin, et de faire mes choix seul. Si tu veux vraiment trouver ton propre langage, tu dois prendre les décisions finales. Quand tu prends ta guitare et que ta voix se pose naturellement dessus, que – du début à la fin du morceau – tu tiens et tu ne sors pas du morceau, c’est que normalement c’est gagné.
De quoi tu pars pour écrire?
 Ça peut être plusieurs choses: une image, une phrase que je peux lire dans un article ou entendue dans un film. C’est plein de trucs comme ça qui font que ça fait tilt dans ta tête. Tu prends un truc, tu le sors de son contexte, et tu crées ta propre histoire à partir de ça. Et ce qui m’arrive souvent aussi, c’est d’avoir cru entendre quelque chose qui m’a inspiré une chanson, et de m’apercevoir en le réécoutant que je me suis complètement trompé. Mais l’erreur m’a quand même donné l’idée d’une chanson.
Ça peut être plusieurs choses: une image, une phrase que je peux lire dans un article ou entendue dans un film. C’est plein de trucs comme ça qui font que ça fait tilt dans ta tête. Tu prends un truc, tu le sors de son contexte, et tu crées ta propre histoire à partir de ça. Et ce qui m’arrive souvent aussi, c’est d’avoir cru entendre quelque chose qui m’a inspiré une chanson, et de m’apercevoir en le réécoutant que je me suis complètement trompé. Mais l’erreur m’a quand même donné l’idée d’une chanson.
Question bonus: quelle est la question la plus pourrie qu’on t’ait posé en interview?
(Il réfléchit longuement) Putain, je ne sais plus. Il n’y en a peut-être pas… Les interviews, c’est un truc particulier, et c’est pour ça que j’aime vraiment discuter avec quelqu’un. Je conçois ça comme une discussion, et si ce n’est pas le cas, ça me saoule vite. (Ca lui revient d’un coup) Si, ah si, le pire truc que j’ai entendu, parce que ce n’était pas dit à moi personnellement… Je joue dans un groupe qui s’appelle Point Carré, une sorte de big band avec dix guitares et deux batteries, un truc un peu à la Glenn Branca. On a fait un concert dans un festival en Belgique. Il y a deux mecs qui sont venus dans les loges pour nous poser des questions à la va-vite. Genre, ils nous filment et ça trace. Ce n’était que des questions de merde, et le pire truc que j’ai entendu a été: ‘est ce que sucer c’est tromper?’. Voilà, c’est la pire question que j’ai entendue dans une interview. Alors le prochain mec qui me la pose, il se prend mon poing dans la gueule. Vous êtes avertis!
Crédits photo:
photos n&b: Vladimir Besson
photos couleur: Myriam Tirler
![]()
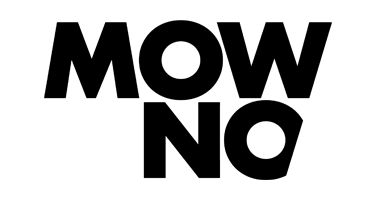



Pas de commentaire