
16 Avr 21 Bruit ≤ désacralise le post rock
De Bruit ≤, on retiendra d’abord une certaine fureur. Fureur politique, déjà, vu que le premier album du quartet toulousain, The Machine Is Burning And Now Everyone Knows It Could Happen Again, développe un message sans ambiguïté sur l’urgence de la question écologique aujourd’hui. Fureur formelle, ensuite, avec cette volonté de ne pas se laisser enfermer dans des cases trop réductrices quant il s’agit de rendre justice à leurs longues plages instrumentales. Clément Libes (basse, violon, claviers, arrangements et production), Théophile Antolino (guitare électrique et guitare folk), Julien Aoufi (batterie) et Luc Blanchot (violoncelle) naviguent avec maestria entre rock symphonique, electro-ambient et néo-classique. Et ce faisant, ils scellent une alliance assez rare entre érudition savante et rage contestataire. Les machines en face n’ont qu’à bien se tenir. Rencontre avec Clément et Théo, les deux têtes pensantes du groupe.
Votre premier album, The Machine Is Burning And Now Everyone Knows It Could Happen Again, démarre par une introduction en mode ‘ambient’ de deux minutes que je trouve particulièrement frappante et cinématique. Composez-vous ou enregistrez-vous avec des images en tête ? Avez-vous des inspirations cinématographiques ?
Clément : Des images, peut-être pas, mais des scénarios, oui. En fait, on sait dans quel mood et dans quelle atmosphère on veut placer l’auditeur à un moment donné. Là, sur cette introduction, l’idée était de créer quelque chose de très organique, où l’on n’arrive pas à discerner ce qui est de l’ordre de l’acoustique et de l’électronique. On voulait représenter une forme d’état méditatif qui, derrière, vient être perturbé par cet espèce de tic-tac électronique représentant l’industrie et sa course contre le temps. Dans cette introduction, on utilise un synthétiseur analogique en même temps que des cors, ainsi qu’une guitare électrique qu’on vient trifouiller en direct avec les pédales, pour donner quelque chose de vivant à ce qui est plus électronique. On utilise aussi du vibraphone joué à l’archet pour créer des sortes de nappes qui font penser à du synthé mais qui n’en sont pas, pour brouiller encore plus les pistes entre ce qui est organique et ce qui ne l’est pas, le tout comme symbolique de cette idée que l’on avait au départ.

Industry tape très fort, dès le début. Je trouve qu’il y a des inflexions presque jazz dans la batterie, et un côté un peu electro ou dubstep à l’ensemble. C’est important pour vous d’insuffler des influences extérieures dans le créneau dit ‘post rock’ ?
Théo : Complètement. Parce que, déjà, on essaie d’échapper à ce truc-là. C’est un carcan qui est même parfois mal vu maintenant, et ça devient un peu compliqué de se définir, surtout quand tu fais du ‘post-rock–mais–pas–que’. En général, si on voit que l’on tombe trop dans la recette post-rock, on essaie d’en sortir. C’est par exemple le cas sur Industry, et à d’autres moments aussi. On reste influencés par certains groupes de ce style, mais ce n’est pas non plus une influence majoritaire. On écoute énormément d’ambient, et après chacun a ses préférences. Clément écoute pas mal de musique électronique, et si on réunit les quatre personnes dans le groupe, ça va aller de l’electro au black metal, en passant par le post rock, évidemment. Ce qui nous motive avant tout à faire cette musique–là, c’est le fait de pas avoir de chant et d’avoir des longs formats. Ce n’est pas du tout dans le but de faire du ‘post rock’, même si c’est appelé de cette manière, vu que c’est un peu la référence actuelle en ce moment. Je me rappelle, il y a peut-être 10 ans, quand on parlait de ce genre de musique, il y avait encore pas mal de gens qui parlaient de rock progressif en pensant à Pink Floyd. Maintenant, le terme post-rock s’est imposé. L’étiquette permet de se raccrocher à quelque chose très facilement. Mais nous, on ne vise pas forcément ça.
Clément : Pareil pour moi. J’aime bien certains groupes dans ce style, j’en ai écouté… Mais en soi, je ne voue pas une religion au post-rock. En soi, je m’en fous, j’écoute des gens qui font de la musique, si ça me touche, tant mieux, si ça me touche pas, je m’en fous. J’aime les formats longs et ceux qui mènent dans la transe. Donc ça peut être aussi bien un morceau de Godspeed qu’une œuvre de Steve Reich, et je les écoute au final de la même manière. J’en n’ai rien à foutre qu’une œuvre soit de la musique contemporaine et que l’autre soit du post-rock. J’essaie de me dégager de cette considération–là.
Par contre, les batteries post-rock m’ont toujours gonflé. Même chez Godspeed, c’est efficace, mais je ne l’écoute pas pour la créativité des parties de batteries. Je trouve qu’il y a un truc un peu redondant, pas hyper-créatif dans les traitements rythmiques du post-rock. Alors c’est sûr, ça fait partie des choses qui créent la transe dans ce genre, mais il y a aussi plein de musiques de transe où les parties rythmiques sont bien plus intéressantes, que ce soit dans la musique électronique, dans le jazz – notamment le jazz moderne, avec des projets comme Dawn of Midi – ou dans des projets metal aussi, où il y vraiment des recherches rythmiques hyper approfondies. On essaie de s’influencer de ce genre d’enregistrements, plutôt que d’essayer de faire un énième morceau à la Explosions in the Sky, avec la grosse montée de toms, le break bien senti au milieu, et puis le gros break sur la ride, etc. etc. On essaie d’éviter ces trucs-là. De temps en temps, on a essayé, mais à chaque fois on jette tout à la poubelle. Parce que ça nous emmerde…
Mais vous avez essayé quand-même, du coup…
Ouais parce qu’on est des adolescents, et qu’on veut goûter au goût de ce truc-là (rires). Mais on s’est vite demandé si on n’avait pas un peu mieux à proposer, finalement… On a effectivement envie de faire un truc qui monte en pression, et qui crée une intensité accrue. Mais au lieu de répéter des vieilles réponses toutes faites avec des montées de toms et tout ça, pourquoi ne pas plutôt essayer de trouver des formules et des biais plus personnels, plus créatifs, en allant chercher des influences ailleurs ?

Dans quels genres de scènes musicales avez-vous évolué avant de former Bruit ≤ ?
Théo : On ne vient donc pas du tout des mêmes horizons. Sur les quatre, il y a deux formations classiques. Par contre, Julien (batterie) et moi, on est complètement autodidactes. Chacun d’entre nous écoutait des musiques différentes, et on a tous eu des projets avant. Avec sa formation, Clément a fait énormément de classique, mais il a aussi beaucoup joué de rock. Julien, notre batteur, on l’a découvert dans un groupe de doom qui évoluait à l’époque sur la scène locale, à Toulouse. Et pour ce qui est de Luc, notre violoncelliste, il a fait le Conservatoire comme Clément, mais il faisait aussi en parallèle de l’électro. Quant à moi, je suis autodidacte à 100 %. J’ai plutôt fait de la folk, et après, je me suis intéressé au post-rock. Quand on s’est connu avec Clément, on a d’abord intégré un projet de pop qui acceptait parfois les longs formats. Donc on s’est retrouvés à manœuvrer dans ces codes-là, avec certains morceaux de 8 minutes, déjà à ce moment-là. Ce qui nous a amené jusqu’à Bruit ≤ aujourd’hui.
Clément : On voulait être encore plus libre que ce qu’on pouvait faire avec ce projet, Kid Wise, qui s’est arrêté il y a 3 ans. On avait signé sur une maison de disques, et donc il a fallu essayer de faire des tubes et des conneries comme ça, avec des formats de 3 minutes. C’était un peu frustrant pour nous. Alors on a monté Bruit ≤ comme un laboratoire où on pouvait un peu se défouler et faire tout ce qu’on ne pouvait pas faire dans Kid Wise.
Théo : Ça avait beau être de la pop, on avait des influences communes avec les gars de ce projet, à l’époque… On s’inspirait de M83 ou de Sigur Rós, des trucs comme ça. Ce dont on ne se rendait pas compte, c’est que la maison de disques nous voyait plutôt comme une sorte de jeune boys band. Je me rappelle, on avait des discussions avec l’éditrice qui nous disait : ‘c’est quoi cet interlude en plein milieu de l’album ? Il n’y a même pas de chant dessus ! Faut l’enlever !’ (sourire). Tu vois pourquoi, avec Bruit ≤, on fait maintenant un album-concept de 40 minutes, avec zéro chant et seulement quatre pistes en tout !
Clément : Moi, je trouve que Interlude, c’est un bon nom d’album. Vous ne trouvez pas ? (rires)
Il est peut-être encore temps de proposer ça à l’ancienne maison de disques ! Pour revenir sur Industry, ce que je trouve marquant aussi, ce sont les glissandos de cordes. Y a t-il des compositeurs ou des musiciens qui vous inspirent particulièrement pour ce genre de plans ?
J’ai fait tous les arrangements de cordes sur l’album. L’autre jour, je suis tombé sur un podcast que j’ai adoré parce qu’il a réussi a spotter exactement d’où ce truc-là me vient. C’est tout simplement How To Disappear Completely de Radiohead, ce magnifique morceau arrangé merveilleusement par Jonny Greenwood. Cet arrangement, il a façonné mon adolescence. L’émotion qu’il me procure, je l’ai dans le corps et en tête en permanence. J’adore cette texture. L’idée du glissando, c’est que ça crée une tension où il n’y a plus vraiment de notes, et où on ne sait pas jusqu’où ça va aller comme ça. C’est quelque chose que l’on trouve aussi pas mal dans les sons de synthés analogiques, dans ce que l’on appelle les ‘glides’, et qu’on n’a pas forcément l’habitude d’entendre tous les jours dans un jeu de cordes. Du coup, dans l’oreille des gens, ça crée une sorte de terrain commun entre la synthèse et l’analogique. Et donc tu peux créer des risers, des choses qui montent, et qui sont typiquement le genre de choses que tu peux aussi faire avec des synthés. Tu les crées avec de la texture acoustique, derrière tu mets du delay ou de la reverb’, et ça devient un truc où tu ne sais plus vraiment ce qui est du synthé ou ce qui est des cordes. Et cette idée de ne plus savoir définir la base du son, c’est quelque chose qui, symboliquement, et par rapport au propos de l’album, m’intéresse beaucoup.
Donc oui, Jonny Greenwood, évidemment (rires). Mais pas que. Après, il y a d’autres compositeurs contemporains comme Xenakis, qui a fait des œuvres qui sont sublimes, avec énormément de glissandos, et d’autres œuvres comme Lontano ou Atmosphères, de Ligeti. Ou celles de Dutilleux, aussi, qui a utilisé le glissando à merveille… S’il y a bien un plaisir à ne pas avoir de frets, avec toutes les problématiques que ça nous crée derrière, c’est bien de pouvoir jouer avec ça. Donc on en use et abuse !

Théo : Le but de Bruit ≤, c’est plus de s’intéresser au son qu’à un air. Ça fait longtemps que je réfléchis à ça en tant que guitariste. Je me suis toujours dit : tu peux faire autant de mélodies que tu veux, même la plus belle possible, elle atteindra toujours un nombre donné de répétitions où tu finiras par t’en lasser. Le plus intéressant pour moi, c’est le son ou l’intensité, pas la mélodie. À la base, je viens de la folk. Quand je me suis intéressé à la guitare électrique, ce n’était pas par l’intermédiaire du rock, et ce n’était pas pour les soli et tout ça. C’était vraiment pour les effets. Je me suis donc directement mis à jouer dans des reverb’ à fond, ou des choses de ce genre. C’est pour cette raison que le post rock m’a fait rentrer dans le monde de la guitare électrique. Avant, cet instrument ne m’attirait pas, à cause du rock en général.
Clément : Il y a des gens qui croient entendre du synthé sur le disque, là où c’est en fait de la guitare. J’ai aussi lu une chronique où l’auteur croyait entendre un chœur ! Et je me souviens également des copains qui venaient au studio… Je leur faisais écouter un mix, et ils me demandaient où était la guitare. Je leur disais : ‘Tu vas voir, je vais l’enlever, la guitare !’. Et là, d’un seul coup, pouf ! Plus rien ! ‘Ah ! C’était ça, la guitare ?’ (rires). C’était assez fun.
À la fin d’Industry, on entend un insert où Albert Jacquard fustige le concept de compétition, notamment à l’école. Pourquoi avez-vous choisi de le mettre à cet endroit ?
Théo : On ne s’est pas dit que le thème de l’éducation devait absolument être traité. Mais ce sample collait bien à l’inspiration globale derrière l’album. Et dans la liste des inserts qu’on avait de côté, ceux qu’on trouvait biens, il fallait que le grain de voix soit également intéressant. Il fallait qu’il y ait quelque chose de musical. Et celui-là collait parfaitement.
Clément : A l’époque où on a commencé à utiliser ce sample, il y avait aussi une sorte de petit message caché. Quand on a monté ce morceau pour la toute première fois, c’était pour compléter notre set, qui ne durait au début que 20 minutes, comme notre EP. On avait été sélectionnés aux auditions du Printemps de Bourges, à Toulouse, et on devait préparer un set de 30 minutes pour ces auditions. Donc on a composé la première version d’Industry pour rallonger le set et avoir un morceau supplémentaire au milieu. Du coup, comme on était dans une bonne grosse compétition française bien traditionnelle, avec des jurys qui doivent dire qui est le meilleur groupe, on s’est dit qu’on allait mettre un petit message sur l’esprit de compétition lui-même, que ça ferait de mal à personne. Et en fait, cette voix est si belle, et ce message si beau, que c’est resté jusqu’à l’album.

Une fois que l’on entre dans le second morceau de l’album, Renaissance, on se rend vite compte que l’ensemble de The Machine Is Burning… raconte une histoire assez précise. Vous pouvez nous en donner ici les grands thèmes ?
Cette histoire, elle parle d’une société fictive – peut-être un peu inspirée de la notre, peut-être un peu inspirée de l’histoire – qui entame une révolution dans le sens où cette révolution est un retour à zéro, un retour à l’apaisement. Mais cette société s’enroule ensuite à nouveau dans un cercle vicieux. Et à cause d’un certain désir de compétition, et d’un manque d’humilité de l’homme, elle finit par retomber dans les problématiques qui l’ont amené à sa chute. L’album commence et finit ainsi par une crise, une chute.
J’ai vraiment la sensation qu’aujourd’hui, notre société est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. C’est une image qui me reste hyper fort en tête, aussi bien dans ce qui se passe socialement que ce qui se passe écologiquement. Même quand je vois des solutions qui pointent le bout de leur nez, elles restent dans un système et une manière de penser qui sont problématiques. Même quand on parle d’écologie, de produits bio, de tout ça, on finit par être en face d’une industrie qui est aussi dans la compétitivité, qui te parle de réduire les coûts de production, qui essaie de détourner les règles pour produire le produit le moins cher, et qui donc finit par produire quelque chose qui n’est pas forcément bon pour la santé, et pas forcément si bon que ça pour l’environnement, qui détruit les terres, etc. Les règles sont en faveur de cette compétitivité. On croit être dans une évolution, mais on se rend compte qu’on tourne en rond. C’est cette espèce de cercle vicieux qu’on voulait dépeindre à travers ce conte philosophique, où l’humanité renait, mais où – à cause du désir de supériorité d’une ou de deux personnes – cette même humanité finit par retomber dans une lutte des classes, dans la guerre, dans l’embrasement de tout…
À propos de ce sujet de l’écologie, d’où vient cet insert en anglais sur Amazing Old Tree ?
Théo : Il provient d’un documentaire sur l’histoire du Earth Liberation Front, qui s’intitule If A Tree Falls. L’ELF est au départ un dérivé d’une organisation anglaise, l’Animal Liberation Front. C’étaient des groupes d’action directe. L’ELF était par exemple un groupe très actif dans les années 90 aux Etats-Unis. Aujourd’hui, la plupart de ses membres sont encore en prison je pense, pour beaucoup de dégradations, des destructions d’usines ou de stations de ski, des choses comme ça… Ce documentaire est hyper intéressant parce qu’il t’explique la base de ce mouvement-là. Tu vois les premières manifestations, la répression à l’époque… Et ce qui est intéressant, c’est que ce sont des questions qu’on se pose toujours aujourd’hui, en fait. On sort de deux ans de révoltes en France. Et toute la réflexion actuelle, elle est sur la question d’où est-ce qu’on peut aller au niveau des modes d’action – à quel moment ça devient trop violent par rapport à ce qu’on peut moralement se permettre de faire nous-mêmes, et par rapport aussi à la vision de l’opinion publique. Dans ce documentaire, tu vois aussi ce qui, petit-à-petit, pousse les gens à se radicaliser, et comment ils finissent par passer à de l’action directe. Le discours qu’il y a dans le morceau, il résume bien ça. On traite ces militants de radicaux parce qu’ils essaient de sauver 5% de la forêt primaire. Alors que 95% de celle-ci a disparu, et que c’est ça qui est vraiment radical. Quand le militant raconte ça, ça montre qu’il y a un discours dans les médias qui te dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et que souvent, si tu l’inverses, tu te rends compte que ce discours est peut-être faux, voire complètement manipulateur.

Pour souligner ce thème de l’écologie, Renaissance fait intervenir pas mal d’instruments et de textures acoustiques (vibraphone, piano, clarinette, guitare folk…). Ça a été compliqué de mettre tout ça en place ? Est-ce que vous avez expérimenté, ou est-ce que tout était écrit dès le départ ?
Clément : C’était écrit dès le départ. En Midi, pour être tout-à-fait honnête. Ensuite, comme je viens du classique, j’ai quelques contacts de supers musiciens qui viennent au studio, je sors les partoches, et puis on enregistre ça. Sur Renaissance, on s’est demandé quel genre de musique on jouerait tous ensemble si on n’avait plus d’électricité. Au début, l’instrumentarium est très acoustique, très folk. Ça pourrait être un groupe de survivants autour d’un feu. Puis l’instrumentarium évolue. Il y a un orchestre, et ensuite un piano, et ça devient des instruments qui sont de plus en plus technologiques, comme dans l’évolution de l’histoire de la musique. Du son de la clarinette nait un son de synthétiseur, qui est dans un timbre assez similaire et joue la même mélodie, et on glisse petit-à-petit vers plus de technologie, tout en gardant quelque chose d’organique.
Tout cela, c’est donc une sorte de dé-zoom, comme un timelapse sur une société qui se reconstruit à partir de ses racines. Depuis qu’on est chasseurs-cueilleurs, on a des arcs. Un jour, un chasseur a fait vibrer sa corde d’arc, ça a fait une note, et il s’est mis à chanter. C’est vieux comme l’histoire de l’humanité. Le seul truc, c’est que nous, on s’empêche de chanter. C’est une démarche qui a un sens aussi, peut-être une forme d’humilité, mais qui permet également de laisser l’oreille se perdre dans ce qu’elle a envie d’écouter. Dès que tu mets une voix, l’intelligence humaine se concentre dessus. On n’y peut rien. On est programmés pour ça, programmés à bien plus écouter la voix que ce qui se passe derrière. Nous, on ne veut pas ce rapport-là avec notre musique. On veut pouvoir donner quelque chose de profond et de large, et que l’oreille se perde dans ce décor-là et puisse elle-même créer sa propre narration. Alors qu’une voix impose toujours une narration.
En écoutant ce ‘décor’ dans Renaissance, j’entends comme un soupçon de Steve Reich sur les croches répétitives du pont central…
Bien vu. C’est clairement un monsieur qui a fait une musique qui a changé ma vie – une musique qui m’a transcendé quand j’étais encore ado, et qui me transcende toujours aujourd’hui. J’ai d’ailleurs eu la chance de le rencontrer et de travailler un petit peu avec lui quand j’avais 20 ans, et ça aussi, ça a changé ma vie, clairement. Dans cette même idée de créer une musique où on perd la notion du temps, ça reste un des grands révolutionnaires, un des maîtres… Et c’est aussi quelqu’un qui a beaucoup d’ironie par rapport au ‘système’, beaucoup d’ironie par rapport aux machines, par rapport à l’industrie. Moi, je vois dans sa musique minimaliste une symbolique de la société dans laquelle on vit, une symbolique qui m’émeut et qui me marque. Quand tu écoutes une pièce comme City Life, c’est frappant d’ironie.
Tu l’as rencontré à quelle occasion, Steve Reich ?
Ça s’est passé aux Pays-Bas. Tous les ans, l’Orchestre Européen des Jeunes de Hollande organise une master class, suivie de tournées en orchestre ou en musique de chambre dans toute la Hollande. Et chaque année, il y a un compositeur résident. J’étais encore étudiant en violon au Conservatoire National de Bruxelles quand ma prof de violon m’a dit : ‘Tu sais qu’il va y avoir Steve Reich en résidence à l’Orchestre des Jeunes de Hollande ?‘. J’ai bossé comme un malade pendant deux semaines pour préparer l’audition et je l’ai eue. Du coup, je suis parti un mois en Hollande, et il est venu intervenir deux semaines. Il a fait des conférences, il nous a fait travailler des pièces à lui. Comme je suis un énorme fanboy, j’ai pris un café avec lui, on a discuté de choses et d’autres (sourire). C’était fantastique, hyper inspirant. J’ai eu une chance inouïe.
Du coup, ce genre d’expériences dans ta formation, il te permet aussi d’avoir des contacts, comme tu le disais tout à l’heure, et de faire venir des musiciens extérieurs. C’est ce que l’on constate par exemple dans cette incroyable version live du titre The Machine Is Burning…, tournée dans une église, où on peut voir un ensemble de cuivres et une organiste. Vous pouvez nous parler de cet endroit ? Comment vous y êtes vous retrouvés ?
Théo : Ce qu’il faut savoir à la base, c’est que ce morceau-là nous est venu grâce à l’idée de l’orgue. Clément avait récupéré un plug-in pour ajouter un son imitant celui d’un orgue sur les pistes numériques. On s’est amusé avec ça, et un premier riff avec ce son-là a tourné. Mais on savait très bien que ce serait irréalisable d’enregistrer le morceau avec un vrai orgue. Donc, quand on a finalisé l’album, Clément a plus ou moins réécrit cette partie pour les cordes, et c’est cette version que l’on retrouve dans l’enregistrement en studio. Mais l’idée de l’orgue était toujours là, quelque part…
Clément : J’ai un copain qui programme des concerts avec une asso sur Toulouse, et il en avait programmé un, un peu fou, dans une église. C’est ce jour-là que je suis rentré pour la première fois dans ce lieu que tu peux voir dans la vidéo, juste un an avant que l’on fasse l’album…
Théo : C’est une église qui s’appelle ‘L’Église du Gesu’, une église néo-gothique qui date du XIXème siècle. Elle est située dans le cœur de Toulouse, et pourtant, on n’en avait jamais entendu parler avant.
Clément : J’ai vu le lieu, j’ai vu l’orgue, je me suis renseigné et je me suis rendu compte que c’était un Cavailler-Coll qui est LE truc ultime des organistes. Ensuite, j’ai appris que l’asso Toulouse les Orgues y avait installé son local, qu’elle organisait des évènements ponctuels là-bas, et que l’église était donc désacralisée. Comme mon pote y avait eu accès, je lui ai demandé si cette asso serait open pour ce genre de projet. Et donc il a monté le truc avec nous, et il a réussi à nous ouvrir les portes de ce lieu incroyable. Après, il a fallu trouver les musiciens, l’organiste, et ça a été un énorme chantier à organiser, y compris le jour-même, afin d’enregistrer tout le monde, et qu’on puisse tous vraiment jouer ensemble. Ça a été la journée la plus éprouvante de ma vie, je pense. Mais, putain, je suis heureux de voir le résultat final. Et je suis heureux aussi de voir comment les gens réagissent en regardant cette vidéo. Ça en valait la peine.
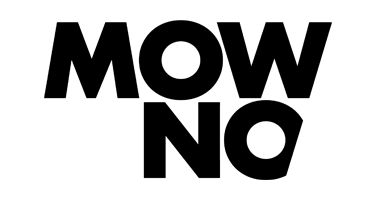



Pas de commentaire