
19 Fév 16 Interview – Drame, tragédie gagnante

Dernier projet en date de Rubin Steiner, Drame s’est frayé – en fin d’année dernière – une petite place confortable dans les estimes critiques et les traditionnels bilans. L’histoire est d’autant plus jolie qu’elle n’aurait jamais du voir le jour. Originalement conçu comme un plaisir récréatif entre musiciens amoureux fou de transe et de krautrock, Drame est finalement devenu à la faveur d’un agenda dégagé et d’un retour en force du chômage (à moins que ce ne soit l’inverse), un projet de premier plan à qui l’on promet désormais tournées et futur radieux. En conséquence, il fallait au moins passer quelques minutes avec Rubin pour qu’il nous aide à faire la lumière sur cet improbable comeback.
Comment juges-tu la réception critique de l’album de Drame par le public et les médias ? Penses-tu qu’il ait reçu un traitement différent des albums que tu as sorti avec le Rubin Steiner Band auparavant?
Rubin Steiner : Je suis hyper étonné des bons retours qu’on a. On ne s’y attendait pas du tout. Au départ, pour plein de raisons, cet album ne devait pas sortir. Ça fait longtemps qu’on l’a enregistré, c’est donc un petit miracle qu’il ait finalement vu le jour. A l’époque, on avait tous des boulots, c’était chaud de tourner, de trouver du temps pour jouer, donc on s’est dit qu’on allait le concrétiser pour nous, pour le plaisir. C’est pour cela que ça s’appelle Drame d’ailleurs, c’était un peu notre petit drame de dire que l’enregistrement marquait la fin du projet. Finalement, c’est sorti, on attendait rien, et on est hyper contents que les gens trouvent ça bien. Même mes parents, ma grand mère kiffent à mort alors qu’on avait vraiment l’impression de faire un truc hyper expérimental. En fait non.
Du coup, Drame a désormais un futur…
Oui, parce que la vie a fait qu’on est maintenant tous au chômage, donc on a le temps de s’y consacrer à fond. C’est d’ailleurs ce qu’on fait. Là, on cherche plein de dates, il y en a déjà de calées, et on a de nouvelles choses à enregistrer. Donc oui, c’est sûr, Drame va continuer en parallèle de Rubin Steiner parce que j’ai aussi plein de nouveaux morceaux qui feront peut être l’objet d’un album cette année, je ne sais pas encore. Mais le groupe étant le même, ça va être dur de faire des choses différentes. Parfois, quand je fais des morceaux et qu’on répète, on ne sait même plus si on fait du Rubin ou du Drame, on en est un peu là. Là, par exemple, on bosse avec Joy Sorman, une écrivaine avec qui on va faire un concert lecture sous le nom de Rubin Steiner parce qu’on a réadapté d’anciens morceaux pour l’occasion, mais il y en aura aussi des nouveaux qui ressemblent beaucoup à du Drame.

Ça devient donc un peu schizophrénique…
Complètement. Du coup, avec Rubin, j’essaye de faire des choses qui n’ont vraiment rien à voir, un peu exotica chelou… Je pense que Rubin va être le côté joyeux de la force, et qu’on va mettre toute la noirceur dans Drame.
Est ce qu’on peut revenir sur la première fois ou tu as entendu du krautrock, si tu t’en rappelles, et sur l’influence que ça a pu avoir sur ton parcours ? D’ailleurs, tu précisais récemment dans une interview qu’il y a toujours eu un ou deux morceaux krautrock sur les albums de Rubin Steiner Band…
Oui, je m’en souviens, c’était au début des années 90, au moment ou j’ai découvert Stereolab. Je me rappelle que j’avais fait écouter ça à un vieux de l’époque, qui devait avoir 40 ans, et qui m’a dit : ‘hey mais dis donc, ton truc, c’est du Neu!’. Il m’avait donc filé le premier Neu, et j’avais un peu halluciné en me rendant compte que Stereolab faisait de la musique allemande de 1972. C’est la première fois que j’ai entendu du ‘krautrock’, même si j’écoutais déjà Kraftwerk sans savoir que c’en était. Mais ce truc motorique, basse-batterie avec des guitares ou du clavier, les morceaux de vingt minutes qui vont tout droit, c’était à ce moment là. Du coup, ca m’a bien tenu pendant les années 90, puis j’ai lâché l’affaire parce que tu en as vite fait le tour. Aujourd’hui, quand je vois des groupes comme Nisennenmondai ou Beak qui font des choses dans cet esprit, je trouve ça pas mal, ca réinvente un peu le truc. Stereolab était plus dans la copie pure et dure. Je trouvais ça cool parce que c’était ma génération, contrairement à Neu! et Faust. Aujourd’hui, on vieillit, et il y a peut être des jeunes qui font des super trucs, je n’en sais rien (rires).
Comment y es-tu revenu alors ?
Ça s’est fait complètement par hasard. On ne s’est pas dit du tout qu’on allait faire du krautrock. D’ailleurs, c’est un terme utilisé par les journalistes, jamais par nous. Quand on a fait ces morceaux-là, on a enregistré des longues impros pendant trois jours, et vu qu’on est tous de pas très grands musiciens, on a fait des choses très simples, on s’est amusé à faire des tourneries très longues avec le moins de notes et d’éléments possibles. Ça a donc mené à des trucs qui peuvent effectivement faire penser à du krautrock, oui.

Est-ce que vous vous êtes quand même imposés des contraintes entre vous, en termes de nombre d’instruments utilisés ou de temps passé sur un même pattern, ou est-ce que ça s’est fait naturellement ?
La vraie contrainte, sans en être une, c’était de ne pas utiliser du tout d’ordinateur. Aussi, d’avoir chacun son instrument, surtout moi qui ait tendance à jouer de la basse, de la guitare, des claviers, de l’ordi, un peu de tout, tout le temps, à vouloir un peu tout maîtriser. Là, je n’ai joué que de la basse. On est donc cinq avec chacun notre instrument. On a aussi essayé de rester toujours dans les mêmes sons, sans sortir de ce qu’offrait nos instruments. On n’a pas mis d’effets dans tous les sens par exemple. Le but, c’était de voir ce qu’on pouvait faire avec notre niveau de musicien, et ce qu’on pouvait sortir des instruments.
Il te reste donc encore quelques heures d’enregistrements. Comment est-ce que tu sélectionnes les segments qui vous semblent susceptibles de devenir un morceau à part entière ?
En fait, ce ne sont pas vraiment des segments. Sur toutes les sessions qu’on a faites, on partait sur des impros sans jamais vraiment faire deux fois la même chose. Du coup, j’ai plein de bouts qui durent entre cinq et vingt minutes. Des fois, il y a un truc magique qui se passe, et les morceaux de l’album, c’est ça : des moments magiques qu’on a réenregistré, qui ont fonctionné soudainement alors qu’ils ne marchaient pas du tout cinq minutes avant ou après.
Drame, c’est donc des bouts de magie…
Complètement. Des trucs qui ne sont pas du tout calculés.
Le batteur, Jeremy Morin, joue dans The Dictaphone, tu as aussi invité Quentin Rollet de Prohibition… Ceux là sont peut être plus familiers avec l’aspect transe du krautrock, mais est-ce que certains de tes musiciens ont pu se sentir déstabilisés au début par cette nouvelle manière d’appréhender la musique ?
Non, pas du tout. C’est quelque chose que nous avons tous voulu vraiment faire. Sur la dernière tournée de Rubin Steiner, on faisait déjà le morceau ‘Canicule’. C’est un truc qu’on répétait, qu’on faisait en balance, qui nous plaisait bien. On s’amusait à le faire durer hyper longtemps. Il y a aussi ‘Amibes’ qui était la fin d’un titre de Rubin Steiner qu’on faisait durer vingt minutes. Ça faisait partie des trucs qu’on avait vraiment envie de faire. Après, on a joué deux fois avec Nisennenmondai, et elles nous ont bien donnés envie de voir ce que ça faisait de rester super longtemps sur la même note. Elles nous ont influencés les filles quand même, tout comme Chausse Trappe qui n’existe plus mais qui a fait deux albums mortels. Pareil, sur scène, ce n’était jamais deux fois la même chose. Deux basses, batterie, violon et souvent une ou deux notes grand maximum, avec de grandes montées complètement folles de transe totale. Ça, ça nous a bien marqués aussi.

Sur scène aussi vos morceaux se modulent, évoluent pas mal ?
En fait, sur scène, ça se joue beaucoup avec des regards complices, et on fait durer le truc pour qu’on soit bien dedans. Mais vu que Jeremy a fait une hernie discale en fin d’année dernière et qu’on a donc du annuler pas mal de dates, on a vraiment fait que deux concerts, qui étaient d’enfer. Ce n’est tellement pas compliqué à jouer qu’on rentre rapidement dans un truc d’énergie et de transe qui est dingue. Et curieusement, ça marche auprès des gens. On a joué au Nancy Jazz Pulsations, en fin de soirée dans un Magic Mirrors qui s’est rempli instantanément parce que c’était à la fin des gros concerts de jazz. Il y a 300 gamins bourrés qui sont arrivés, on a craint de leur faire peur mais ils étaient au taquet, même avec Quentin qui faisait ses trucs de sax complètement barrés.
Revenons aux groupes de krautrock actuels comme Beak ou Cave. Comment expliques-tu la longévité dans la qualité des groupes du genre ?
Encore une fois, ‘krautrock’, ça ne veut vraiment rien dire. En fait, nous, on a eu envie de faire de la techno avec une batterie, une basse, des percus et un synthé, sans boite à rythme. Je crois que c’est ce qui se passe avec des groupes comme Cave ou Nisennenmondai : un truc qui est de l’ordre de la transe techno qui, moi, me rappelle aussi vachement le jazz spirituel, des trucs d’Alice Coltrane aussi. Après, je ne connais pas des masses de représentants actuels de cette musique donc je ne serais pas trop catégorique. Il y a probablement des dizaines de groupes pourris dans ce genre aussi.
Tu écoutes beaucoup de techno ? C’est une musique qui te parle ?
Oui beaucoup. J’ai un faible pour l’ami Ivan Smagghe notamment, je suis vraiment fan des remixes qu’il fait dans le cadre du projet It’s a Fine Line. J’aime bien Clément Meyer, Tomas More… Mais mon drame – sans jeu de mot – c’est que j’essaye depuis des années d’en faire, mais je n’y arrive pas. On croit que c’est très simple, qu’on fait des morceaux avec une boite à rythme et un bout de synthé, alors qu’en fait c’est hyper difficile. Je m’arrache les cheveux, mais je n’y arrive pas.
Que penses-tu qu’il te manque ?
Je ne suis jamais vraiment allé en club. Je m’en fous d’écouter de la techno en club, je l’écoute à la maison, avec l’attention du musicien. Je n’ai pas ce truc d’efficacité club, je ne sais pas faire et ça me rend malade parce que j’ai tout le matériel pour. A chaque fois que j’essaye d’en composer, je trouve ça nul.

Entre 2009 et 2015, tu as été programmateur au Temps Machine, une salle de concert de Tours. Ça a été ton activité la plus institutionnalisée au sein de la musique. Tu as même dit avoir arrêté avant d’être trop blasé. Du coup, je voulais savoir ce que tu retenais de cette expérience, tant du côté positif que négatif…
Dans le positif surtout, c’est de n’avoir jamais autant vu de concerts de ma vie, et beaucoup de bons. C’est cool de rencontrer des musiciens, de se rendre compte que les plus normaux et les plus humbles ne sont pas forcément ceux qu’on croit. Les petits jeunes se la pètent souvent beaucoup plus que des vieux briscards qui n’ont plus rien à prouver, ce qui me fait toujours beaucoup rire. Tout ce qui se situe au niveau du buzz et des petites modes éphémères, c’est dingue comme ça monte très vite à la tête des gamins ! Les mauvais côtés, eux, ne sont pas très intéressants. Je préfère oublier tout le côté business ou la musique ne passe pas vraiment au premier plan. C’est assez difficile à vivre quand on aime vraiment ça.
C’est ce qui t’a poussé à raccrocher ?
Oui, même si c’était prévu que je ne le fasse que pendant cinq ans. J’ai arrêté un tout petit peu plus tôt, mais ça tombait bien. J’en avais marre, et ça prend surtout énormément de temps. C’est plus que des horaires de bureau parce que tu ramènes du boulot à la maison, ça t’accapare l’esprit. Puis j’avais envie et besoin de refaire de la musique, et je n’avais vraiment pas le temps en bossant à côté.
Tu dis être constamment en quête de musiques qui te surprennent. Qu’est-ce qui t’a sauté aux oreilles dernièrement ?
Heuuu… Le premier album de Cavern of Anti Matter, le projet de Tim Gane de Stereolab, m’a beaucoup plu. Ils viennent tout juste d’en sortir un nouveau qui est très bien aussi. D’ailleurs, on est content parce qu’on va jouer avec eux à la Route du Rock. Sinon, j’aime bien Harmonious Thelonious qui sort ses disques sur Italic, un label allemand. Il y en a plein d’autres mais là, j’ai le cerveau en compote.
![]()
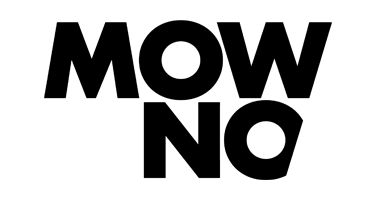



Pas de commentaire